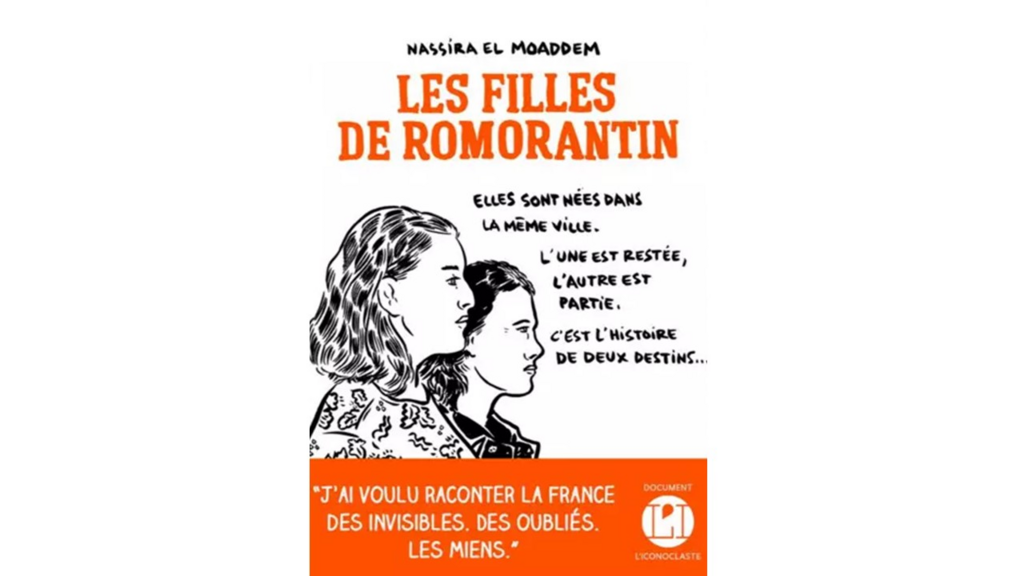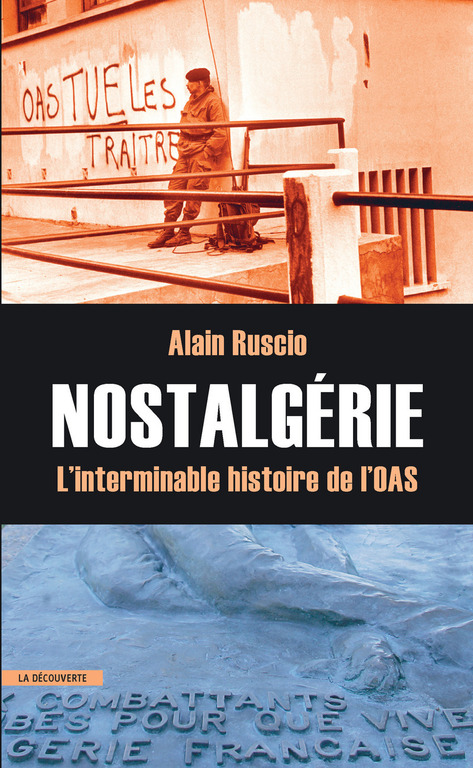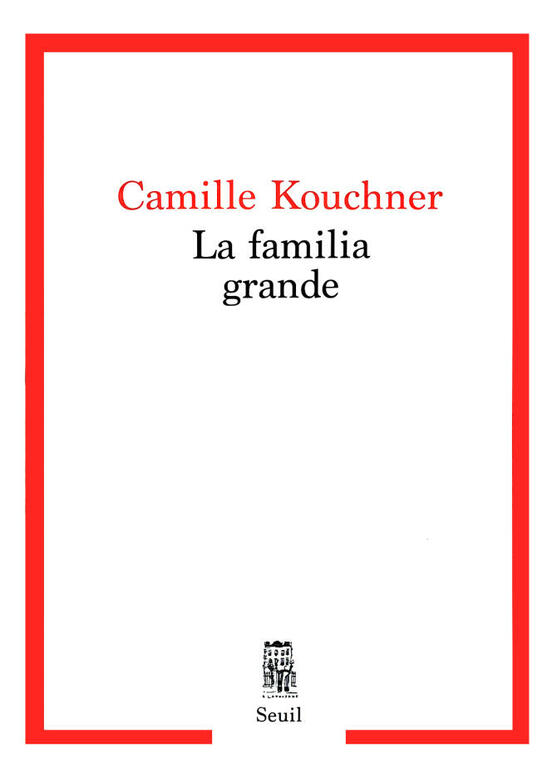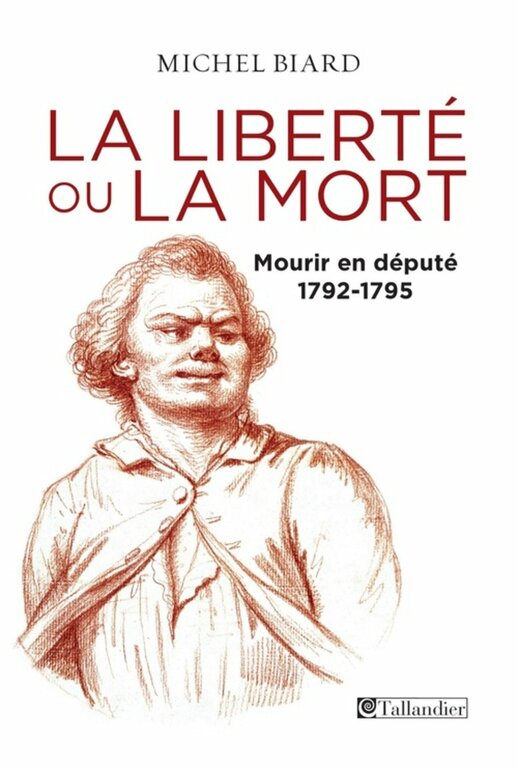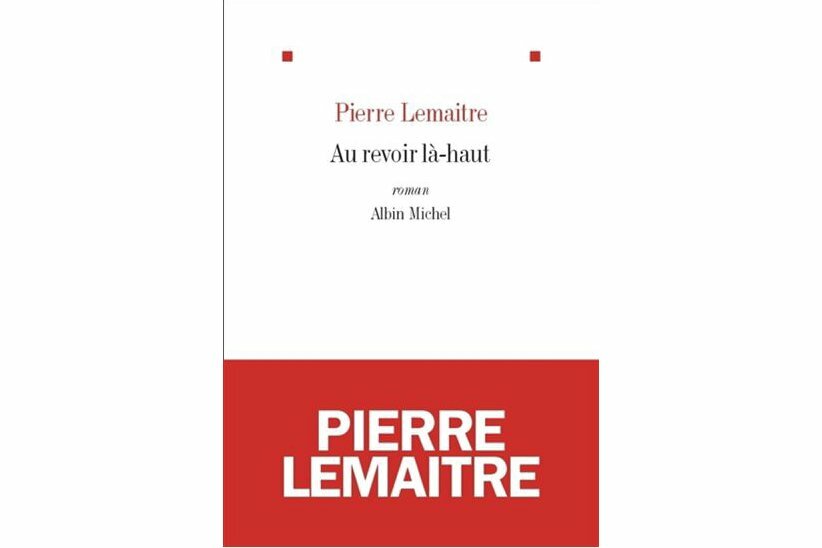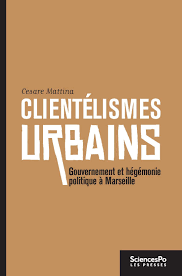Alain Ruscio dresse une histoire interminable, si l’on puit dire, par ses deux extrémités : elle commence il y a longtemps et peine à se clore aujourd’hui ; elle est conséquemment très longue. La genèse de l’organisation terroriste qui se livre à de très nombreux attentats pendant et après la guerre d’Algérie est selon l’historien à rechercher dès la première colonisation, dans les années 1830. Très tôt, en effet, les colons intègrent une « culture de la milice ». Armés, encouragés à l’être par le pouvoir métropolitain, ils se dotent face à la majorité native d’une « mentalité d’assiégés ». La ségrégation n’est pas officielle dans l’Algérie coloniale mais elle existe de fait. Si elle est ponctuellement débordée, la juxtaposition des européens et des natifs l’emporte. Les différences abyssales de niveau de vie y sont décrites, de même que les droits absolus d’une minorité infime. Cet ensemble de cadres, très précocement établis, débouche logiquement sur un racisme généralisé dont Ruscio démontre qu’il est dès lors intrinsèque à toute colonisation. Surtout, il rappelle que les quelques initiatives tendant vers l’égalité des droits entre natifs et européens restent au mieux extrêmement limitées, au pire lettre morte : Clémenceau doit imposer par la force la naturalisation de quelques milliers de combattants de la 1ère Guerre Mondiale, le projet Blum-Violette qui envisageait la création de 23 000 citoyens pour 1,5 millions d’hommes adultes en tout reste lettre morte. De fait, « l’égalité n’est jamais envisagée » en Algérie.
Alors que l’insurrection est déclenchée, Alain Ruscio établit méticuleusement le processus de mise en place de l’OAS : il montre comment les comités
« contre-terroristes » se forment à partir de 1955, et comment leur activité est alors théorisée par certains de leurs membres. Pour Jean-Claude Perez,
« il est très important que la population française d’Algérie se rende compte, en particulier dans notre quartier, qu’il y a une organisation occulte, qui peut du jour au lendemain faire aussi bien (…) que le FLN ». Il montre comment la violence des attentats perpétrés dès 1956 et l’indifférence des pouvoirs publics investissent le FLN d’une certaine posture de
« héros » et de
« défenseurs du peuple » au sein de la population musulmane. Si les attentats de l’ORAF
[i] visent évidemment les natifs, ils n’épargnent cependant pas les pieds-noirs, avec l’ambition cynique de mettre le feu aux poudres : ses bombes éclatent ainsi le 29 décembre 1956 le long du cortège funèbre de Amédée Froger, le maire de Boufarik très populaire au sein de la communauté européenne d’Algérie.
Il et passionnant de voir comment les ultras de l’Algérie française coopèrent, un temps, avec les réseaux gaullistes : d’abord lancés dans une course de vitesse pour « capter la colère des pieds noirs », ils versent complètement dans la collusion lors de la préparation de la prise du gouvernement général. Jean-Robert Thomazo fait ainsi partie de l’équipe qui met au point le plan tout en assurant le discret contact avec les gaullistes. C’est à l’occasion du 13 mai 1958 que le cadre légal finit de s’écrouler en Algérie, le pouvoir militaire exigeant à partir de ce moment-là des mesures du pouvoir civil. Les gaullistes exploitent alors vigoureusement l’atmosphère de pronunciamento, parallèlement aux ultras : Pasqua réunit les factieux à Marseille tandis que Thomazo et Arrighi contrôlent la Corse et que Lagaillarde et Le Pen ourdissent un coup de force contre la chambre des députés. On voit bien toute l’exploitation que les partisans du général peuvent faire de cette menace, toute leur habileté en la circonstance résidant dans le fait qu’ils l’encouragent sans sembler en être. « A posteriori, la légende gaulliste a façonné l’image d’un chef uniquement soucieux des grandes décisions, laissant à ses subalternes les petites manœuvres. En faut, tout ce qu’on a pu recueillr depuis dément cette légende. On sait que le Général a rencontré un Delbecque en partance pour Alger le 6 mars – donc deux mois pleins avant le début de la crise – et qu’il lui a dit de « faire attention », de « ne pas aller trop loin » faute de quoi il pourrait se retrouver « au gnouf » (…). De fait, il n’est pas certain que les Pieds-noirs aient bien compris De Gaulle lors de son discours du 4 juin 1958 : De Gaulle y dit notamment qu’il y a alors en Algérie « Dix millions de Français et Françaises » », et Ruscio de souligner que les européens d’Algérie n’ont pas voulu y entendre que c’était là une remise en cause explicite de l’inégalité qui prévalait en Algérie.
Après l’évolution - rapide - de De Gaulle, le divorce est consommé entre le président et les ultras. C’est alors l’acte de naissance de l’OAS, marqué dès le début pas l’infâmie, puisque c’est au sein de l’Espagne franquiste que le mouvement éclot, certains chefs de l’OAS ayant même conduits en avion en Algérie par des phallangistes historiques. A partir de ce moment-là, l’OAS n’a plus qu’un objectif : souder entre eux les européens d’Algérie en creusant le fossé avec les populations locales. Tous les moyens sont bons : déchaîner la violence, prendre le maquis, exploiter la colère des Pieds-noirs. Et c’est là le vrai but politique de l’OAS. Les bonnes questions sont je trouve posées : si l’action de l’OAS est globalement approuvée par les européens d’Algérie, la contrainte est exercée par les factieux sur les civils qui restent assez nettement en retrait : de fait, le nombre des activistes de l’OAS n’a jamais dépassé les quelques milliers ; au-delà, elle estime que le groupe des européens doit faire bloc, et ne répugne pas, à ce titre, à traquer tous les « traîtres ». La séparation nette que l’OAS trace entre les siens et les autres n’est pas exempte d’amateurisme : « (…) les commandos ajoutèrent au crime la bêtise la plus crasse : plusieurs autres Lévy avaient été auparavant assassinés…pour cause d’homonymie. On lisait les résultats dans le journal du matin, et on voyait « Monsieur Paul Lévy », et on disait « Nom de Dieu, ce n’est pas celui-là » ». Y compris lorsque la guerre est portée en métropole, l’OAS est ainsi décrite comme « peu organisée, mal armée, à peine secrète » (Jacques Delarue). On lit avec intérêt les pages sur le recours au racket pour financer l’organisation, les tentatives d’assassinat de De Gaulle.
Mais ce sont finalement les derniers chapitres qui sont les plus brûlants, ceux qui concernent l’après-Evian : on y voit les ramifications idéologiques de l’OAS ; Si Alain Ruscio ne fait pas des ultras un mouvement à proprement parler fasciste, il montre très clairement qu’un certain nombre de ses activistes étaient des fascistes réfléchis et structurés. La description de leurs projets est à ce titre édifiante : un réduit européen autour d’Oran non exempt d’une inspiration de l’apartheid est un temps envisagé. Il est par-dessus tout intéressant de voir comment la question raciale revient, et finalement divise les membres de l’OAS : les thèses d’un intégrationniste comme Jacques Soustelle collant difficilement avec celles de ceux qui se vivaient comme des défenseurs de l’Occident Chrétien. Enfin, la question de la mémoire et de ses échos dans le milieu politique français, en particulier dans le sud-est de la France est cruciale : des parlementaires comme les Tabarot
[ii] poursuivent avec acharnement la guerre des mémoires en demandant que la fusillade de la rue d’Isly soit commémorée. Si l’on ne peut qu’être sensible au drame des familles pied-noir qui ont perdu des leurs lors de la manifestation, on doit cependant rappeler, avec Ruscio, le cynisme des ultras qui ont instrumentalisé ces malheureux en les jetant sur les soldats. On voit d’ailleurs assez mal pourquoi la France s’
« humiliant » en reconnaissant les méfaits de la guerre coloniale s’honorerait de commémorer le drame de la rue d’Isly. Le principe d’un travail de mémoire ne peut pas être de faire le tri parmi les morts : c’est la colonisation et la violence qui lui est consubstantielle qui a tué tous ces malheureux.
Le livre de Alain Ruscio est un ouvrage de très bon aloi : loin de brasser sans nuance les multiples questions mémorielles, il fait un sort à ceux qui brocardent la « repentance ». Il n’y a pourtant que les nostalgiques de l’Algérie française pour parler de repentance, comme il n’y a qu’eux pour parler d’ « aspects positifs ». Le travail de l’historien se situe tout ailleurs : il dit les faits, retrace des causalités. Un travail inspiré dont ceux d’entre nous qui regardent vers l’avenir doivent de toute évidence se servir pour avancer dans la voie d’une véritable amitié entre les peuples algérien et français.
[i] Organisation de Résistance de l’Afrique Française, ancêtre de l’OAS.
[ii] Michèle Tabarot est députée des Alpes Maritimes. Son frère cadet, Philippe est sénateur du même département.